|
III. Pathologie Vasculaire Cérébrale
A. La Circulation Cérébrale
cf. deuxième partie LES GRANDES FONCTIONS : La Circulation Cérébrale.
B. Sémiologie des Accidents Vasculaires
On suspecte un accident vasculaire devant l'installation BRUTALE d'un syndrome neurologique FOCAL ou MENINGE.

En général, plus le sujet est jeune, plus le déficit est apparemment bénin, plus il y a urgence à en connaître le mécanisme, en raison des possibilités thérapeutiques. En effet, tout neurone détruit ne repoussant
jamais, SEULE LA PREVENTION EST EFFICACE en matière de pathologie cérébro-vasculaire. Tout AVC massif entraîne des lésions rapidement définitives... le seul traitement restera alors la
rééducation si elle est possible. Un neurone en état de privation d'apport sanguin meurt en 8 minutes...
C. Les Accidents Ischémiques
1. Thrombose
Une thrombose survient sur un vaisseau malade depuis longtemps, chez un sujet volontiers âgé. La thrombose se voit chez le sujet poly-athéromateux. Certains syndromes associent ischémie et maladie
familiale de la substance blanche (CADASIL).
2. Embolie
Les embolies peuvent être d'origine cardiaque ou artérielle.
Si l'état neurologique à la suite de l'accident vasculaire cérébral n'est pas d'emblée catastrophique, La recherche systématique d'une pathologie emboligène s'impose devant un accident vasculaire cérébral,
surtout chez le sujet jeune EN RAISON DU RISQUE DE RECIDIVES :
- Artères : sténose athéromateuse au niveau de la bifurcation carotidienne.
- Coeur : rétrécissement mitral, troubles du rythme, pathologie valvulaire, infarctus,...
3. Lacune
Petits accidents ischémiques profonds favorisés par le terrain diabétique ou hypertendu. Peuvent aboutir en se multipliant à un état de démence artériopathique (état lacunaire) : démarche à petits pas,
détérioration intellectuelle massive.

Lacunes cérébrales bilatérales - aspect en IRM
4. Lésions diffuses
Chez le grand hypertendu peuvent apparaître des lésions diffuses sous-corticales aboutissant à une démence (encéphalopathie de type BINSWANGER), "leucomalacie hypertensive" ou "leucoaraïose".
D. Les Accidents Hémorragiques
1. Hémorragie Cérébrale Spontanée
Hématome intracérébral spontané de l'hypertendu siégeant habituellement dans la profondeur des hémisphères cérébraux. Les hémorragies sont plus graves à court terme, mais dans l'ensemble les
survivants ont un meilleur pronostic fonctionnel que les ischémies, car l'hématome détruit moins le cerveau que l'ischémie.
2. Hémorragies Méningées
Les hémorragies méningées
- se traduisent par un syndrome méningé brutal : céphalées, troubles de la vigilance éventuelle, photophobie.
- peuvent être sans cause évidente, mais il faut toujours rechercher une malformation vasculaire (artériographie) dont l'indication chirurgicale est habituellement formelle : en effet, en l'absence de cure
chirurgicale, le risque de récidive hémorragique est excessivement élevé.
3. Malformations Vasculaires
Les hémorragies par rupture de malformations congénitales sont de 2 types :
- peuvent être le reflet d'une rupture de malformation artérielle congénitale (anévrysme) ; il y a alors un
risque majeur de récidive dans les premiers jours, et obligation de poser rapidement l'éventuelle indication neuro-chirurgicale.
- d'autres fois, le saignement peut être provoqué par la rupture d'une malformation artério-veineuse congénitale (angiome). Ces malformations entraînent volontiers des hémorragies cérébro-méningées. Elles
sont parfois révélées AVANT saignement par des crises d'épilepsie ou des migraines.
E. Les Phlébites cérébrales
Le réseau veineux cérébral est indépendant du réseau artériel. Il existe un réseau veineux profond et un réseau veineux superficiel. Les thrombophlébites cérébrales sont d'étiologies diverses : post traumatiques,
consécutives à une pathologie infectieuse du voisinage, post-partum. Elles peuvent constituer une complication de la prise de contraceptifs.
Leur tableau clinique associe habituellement : des signes d'hypertension intracrânienne, des crises convulsives, des signes déficitaires focaux qui dépendent de la veine concernée. La topographie est
souvent plus diffuse qu'en cas de thrombose artérielle. Comme les phlébites des membres, elles peuvent provoquer des embolies pulmonaires.
Le traitement associe les anticoagulants et les anti-inflammatoires. Les anticoagulants peuvent être dangereux car le ramollissement cérébral d'origine veineuse est souvent hémorragique (importance du
scanner avant la mise en route du traitement).
F. Epidémiologie des Accidents Vasculaires Cérébraux
(source : Encyclopédie Médico-Chirurgicale de Neurologie)
1. Epidémiologie
a. Age et Sexe
Dans l'ensemble les chiffres des femmes approchent les minimas, les hommes les maximas.
b. Mortalité
Hémorragie : 50 % des décès dans les 48 H. 65 % des décès des infarctus cérébraux se produisent après 7 jours.
Cause du décès habituellement cardio-vasculaire. Complications cardiaques 74 %. La récidive d'AVC serait souvent hémorragique.
c. Eléments de pronostic
Associations symptomatiques, coma, âge avancé : mauvais pronostic. Cumul de facteurs de risque : idem.
d. Déclin des AVC
Diminution de l'ordre de 30 % depuis 1970 dans tous les pays : traitement de l'HTA, habitudes alimentaires, tabac ?
e. Economie des AVC
En France, la pathologie vasculaire cérébrale coûterait 10 Milliards de Francs (cette somme ne représenterait que 10 % des dépenses réelles).
2. Facteurs de risque
a. Hypertension artérielle
L'existence d'une HTA multiplie par 5 le risque d'AVC. Chaque augmentation de 10 mm des chiffres tensionnels systoliques augmente le risque d'AVC thrombotique de 30%.
Chiffres élevés : augmentation importante de la gravité de l'accident, du nombre des lacunes.
La TA "banale" semble aussi nocive que la TA "basale" : inutile de faire reposer le sujet avant la prise de tension.
b. Diabète
Augmentation souvent liée à la conjonction HTA + diabète.
Aggravation des conséquences de l'AVC.
Augmentation du nombre de lacunes.
c. Dyslipidémies
Hypercholestérolémie > 2.50 g/l intervient dans les infarctus cérébraux AVANT 60 ans EN PRESENCE d'HTA SI elle était présente avant l'âge de 50 ans.
d. Excès de poids
Plus dangereuse chez la femme que chez l'homme. Si surpoids > 30 %. Aggrave les autres facteurs.
e. Tabac, Café, Activité physique
Récemment le facteur tabac semble démontré; il n'en est pas de même pour le café et l'effort.
f. Alcoolisme
Elévation de la TA chez l'alcoolique. Accidents du Week-End. Surtout facteur de risque chez les femmes d'âge moyen et les hommes jeunes.
g. Hémoglobine et Hématocrite
Chez les athéromateux
h. Comportement de type A
Ambition, agressivité, impatience : ???
i. Climat
Mortalité plus basse dans les climats tempérés. Danger des températures extrêmes pour les personnes âgées.
3. Tableaux synthétiques
Incidence des accidents vasculaires cérébraux
(Par an et pour 1000 Habitants)
Age Minimum
Moyenne Maximum
35-44
- 0.25 -
45-54
0.60 1.00 1.80
55-64
2.50 3.50 5.00
65-74
6.00 9.00 12.00
75-84
15.00 20.00 25.00
85+
- 40.00 -
(si on compte les rechutes, chiffres + 25 %)
Prévalence des accidents vasculaires cérébraux
(nb total d'individus à un moment donné)
Age Minimum
Moyenne Maximum
35-44
- - -
45-54
10 20 40
55-64
17 35 65
65-74
30 60 100
75-84
50 95 25
85+
- - -
Nature de l'accident vasculaire cérébral
N=694/ Thrombose Lacune
Embolie Hémorragie Anévrysme
135 cas
26.00% 29.00% 13.00% 15.00% 2.00%
Mortalité
CAS DCD 1 mois
Hémorragies méningées
250 125
Hémorragies cérébrales
375 300
Ischémie cérébrale
1875 750
TOTAL
2500 1175
Tension artérielle et AVC pour 1000 personnes
TA systolique
120 140 160 180
Incidence
2.3/1.6 0.7/2.0 2.8/8.4 3.0/19.8
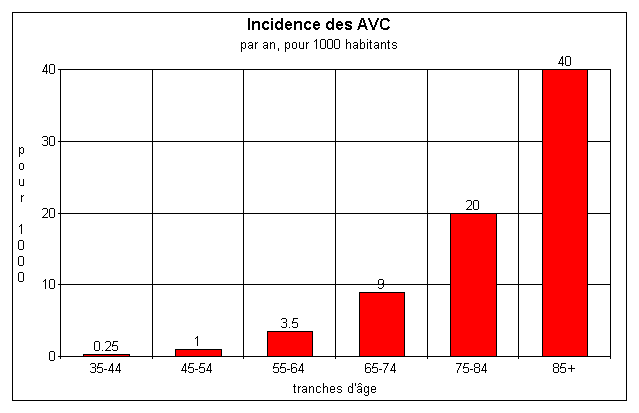
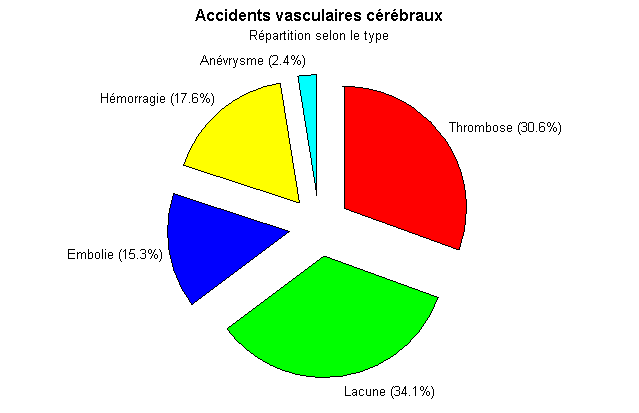
F. Conduite pratique du raisonnement
PRISE EN CHARGE D'UN ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL
Il n'y a pas deux AVC superposables (dépend du terrain, du type, des suppléances anatomiques,..)
QUI DIT ACCIDENT VASCULAIRE DIT Apparition brutale d'un syndrome focal ou méningé
Plus un AVC est apparemment bénin ... Plus le sujet est jeune
et plus il est urgent de savoir si c'est vraiment un AVC... compte tenu du risque d'aggravation
Un AVC peut être (rarement) apparemment progressif (formes "pseudo-tumorales") ou apparemment progressif, en "marches d'escalier". Il peut en conséquence être mal reconnu au
début, ce qui risque de faire rater la période durant laquelle on peut encore prévenir le déficit neurologique risquant à terme d'être définitif.

|